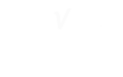« Mais pourquoi vous faites ça ? », « Vous n’avez pas honte de rendre hommage à un tyran sanguinaire ? », « Vous célébrez la Terreur maintenant ? »…
Ces questions, je les vois chaque année depuis maintenant quatre ans. En effet, lorsque j’ai été élu député, j’ai proposé qu’on organise chaque année à Arras un hommage à Maximilien Robespierre le jour de sa mort, le « 10 thermidor an II », soit le 28 juillet 1794. Cette année, pour que cela tombe un dimanche, nous ferons cela le 27 juillet (rendez-vous à 17h au 9 rue Maximilien Robespierre à Arras) : hasard de l’existence, c’est aussi un jour historique pour Robespierre, celui de son entrée au Comité de Salut public en 1793.
Mais pourquoi diable rendre hommage à Robespierre alors qu’il est aujourd’hui encore perçu comme un tyran, un monstre, un horrible bonhomme, un tueur de masse, un dictateur, l’artisan de la Terreur… j’en passe et des meilleures (ou des moins bonnes, plutôt) ?
Se poser la question, c’est déjà en partie y répondre : c’est que la légende noire de Robespierre est tout simplement… fausse.
La Terreur n’est pas ce que nous en avons appris
Bien sûr, Robespierre était un être humain. Il était donc faillible. Il a donc pu commettre des erreurs. Il en a commis assurément. Mais pas celles qu’on lui reproche. C’est même plutôt l’inverse : de ce dont on l’accuse généralement, en particulier des guerres de Vendée et ce qu’on appelle « la Terreur », il a cherché à modérer les violences et à en confondre les coupables. Robespierre était un homme de formules dont l’onde de choc parle encore deux siècles plus tard. Il dit : « Je suis né pour combattre le crime, non pour le gouverner ».
Il faut lire les travaux des Historiens sur Robespierre. Et en particulier ceux de Jean-Clément Martin : « Robespierre : la fabrication d’un monstre » ou encore « La Terreur : vérités et légendes ». Je conseille ceux-ci en particulier parce que Jean-Clément Martin a fait un travail considérable autour de « La Terreur » et il a démontré scientifiquement, à base des archives disponibles, que… La Terreur « n’existe pas ».
Pour mieux le dire, le Comité de Salut public met bien en place un tribunal révolutionnaire (d’ailleurs, c’est Danton et non Robespierre qui pousse à la création de ce tribunal). Ce tribunal va bien condamner un grand nombre de personnes à mort (d’ailleurs, Robespierre essaie d’en limiter le nombre et s’investit parfois personnellement pour « sauver des gens »). Mais jamais une politique de « la terreur » n’est décidée officiellement par qui que ce soit. Bien au contraire, « La Terreur » (avec une majuscule) est une construction politique des assassins de Robespierre pour définir une période de grande violence et lui mettre sur le dos toutes les fautes de cette période. Cela leur permet de justifier son meurtre sans aucun procès, ainsi que celui d’une centaine de ses camarades qui sont envoyés à la guillotine le même jour que lui (comme son frère, Augustin – dit « Robespierre le jeune » – ou encore Saint-Just).
Ironie du sort : ceux qui construisent cette légende noire sont précisément ceux qui sont responsables des pires crimes de la Révolution. Fouché, Carrier et d’autres, qui se comportent comme de véritables monstres en Vendée ou à Lyon. Robespierre voulait les confondre. Ils le prennent de vitesse et lui mettent leurs propres crimes sur le dos.
Autrement dit : la présentation de Robespierre comme un monstre est une propagande fabriquée par ses adversaires politiques il y a plus de deux siècles. Et aujourd’hui encore, beaucoup répètent cette propagande sans l’interroger. Comment leur en vouloir, d’ailleurs ? Puisque pour aller contre cette propagande, il faut avoir un intérêt particulier pour l’Histoire de la Révolution, lire les travaux des historiens, aller au-delà des apparences… et se préparer à une adversité considérable puisque dire que Robespierre est digne d’un hommage, c’est se préparer à affronter cette propagande. Mais quand on est insoumis, on a l’habitude de devoir affronter des accusations mensongères (elles sont débitées en continu sur CNews si vous en voulez un échantillon représentatif).
Robespierre ou Napoléon ?
Pour susciter votre interrogation et votre curiosité, je pose toujours à mes interlocuteurs une question simple. Elle a l’avantage de placer la réflexion directement où il faut, c’est-à-dire sur le terrain de la lutte contre nos propres préjugés. Cette question est la suivante : « Pourquoi rendre hommage à Napoléon qui a rétabli l’esclavage plutôt qu’a Robespierre qui a voté son abolition ? ». Et on peut la décliner : « Pourquoi rendre hommage à Napoléon qui a mis fin à la République plutôt qu’à Robespierre qui a participé à la faire naître ? ». « Pourquoi rendre hommage à Napoléon qui a tué des millions de personnes et affaibli la France dans des guerres de conquêtes plutôt qu’à Robespierre qui a mené des guerres défensives et participé à redresser une situation militaire où tout semblait perdu ? ». J’invite les admirateurs de Napoléon à s’intéresser à ce qu’il a fait en Haïti : ils y découvriront une défaite de l’armée de Napoléon qu’ils ne connaissent pas, la bataille de Vertières ; ils y découvriront la brutalité de ceux qui ont essayé d’y rétablir l’esclavage et n’y sont pas parvenus.
Il faut toujours gratter le vernis de nos propres certitudes et accepter de s’ouvrir à des opinions contraires. Car au-dessous se trouve parfois des éléments qui nous font grandir nous-mêmes. Célébrer Robespierre quand il est vilipendé, c’est permettre d’ouvrir deux chemins : d’abord celui d’une amélioration de la connaissance historique de notre patrie commune, ce qui n’est jamais inutile, ensuite celui de l’esprit critique. Car dès lors qu’on a accepté l’idée de mettre en doute ses propres certitudes, la voie est prise pour un accroissement de la connaissance et une amélioration du débat politique et démocratique en le basant sur la raison, sur les faits, sur des éléments matériels et des analyses scientifiques. Rendre hommage à Robespierre choque ? C’est parce qu’on ne connaît pas assez Robespierre.
Ce(ux) que défendait Robespierre
Qui était-il ? Les historiens en débattront sans doute jusqu’à la nuit des temps. Ce dont on peut parler en revanche, c’est des idées qu’il a défendues. Et sur ce point, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’est pas trompé de combats. 231 ans après sa mort, comment ne pas y voir l’un des esprits les plus éclairés de son temps ?
Robespierre se bat contre le suffrage censitaire, c’est-à-dire réservé aux riches. Il s’oppose à la peine de mort pour les crimes de droit commun. Il refuse les guerres de conquête et dit : « personne n’aime les missionnaires armés ». Il s’oppose à l’esclavage et dit : « Périssent les colonies, s’il doit vous en coûter votre bonheur, votre gloire, votre liberté. Je le répète : périssent les colonies et les colons s’ils veulent, par des menaces, nous forcer à décréter ce qui convient le plus à leurs intérêts. »
Robespierre se bat pour des principes. Ceux de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, d’abord, même s’il trouve qu’elle ne va pas assez loin (il en proposera une version bien plus puissante, dont beaucoup d’articles seront repris dans la Constitution du 24 juin 1793, celle de la Ière République). Il se bat pour le droit de vote des juifs et des comédiens qui en étaient privés ; son erreur sur ce point sera de ne pas avoir porté l’idée d’un suffrage réellement universel, c’est-à-dire qui ne soit pas uniquement masculin.
Ouvrant la voie à la République sociale, Robespierre définit un droit à l’existence auquel le droit de propriété doit être subordonné ; il déclare : « nul homme n’a le droit d’entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim ». Robespierre se bat pour le droit au bonheur, pour le droit à l’éducation, à la santé, au repos des anciens et des personnes en situation de handicap qui ne peuvent travailler. Il se met du côté des pauvres contre les puissants. Il refuse d’avoir fait tomber la domination féodale pour établir une nouvelle domination par l’argent. Il veut que le peuple puisse exercer sa souveraineté partout, tout le temps ; ainsi, dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qu’il propose, il écrit : « Le peuple est souverain : le gouvernement est son ouvrage et sa propriété, les fonctionnaires publics sont ses commis. Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement, et révoquer ses mandataires. »
Oui, Robespierre c’est tout cela, et bien d’autres choses encore que je ne mets pas ici pour ne pas rallonger inutilement un texte déjà fourni. Qu’il me soit permis de vous donner un dernier élément. Si la devise de la France est « Liberté, Égalité, Fraternité », c’est un peu (beaucoup) grâce à lui. Après avoir sans doute vu cette formule dans un article de Camille Desmoulins sur la Fête de la Fédération en 1790, il propose cette formule comme devise pour les Gardes nationales en décembre 1790 dans un discours non prononcé mais imprimé, distribué et enregistré aux archives de l’Assemblée nationale. Pour le dire de manière un peu abrupte : être fidèle à la devise de la République, c’est être un peu Robespierriste même si on ne le sait pas.
« Le robespierrisme, c’est la démocratie » – Jean Jaurès
Je conclus. J’espère vous avoir bien montré pourquoi rendre hommage à Robespierre a du sens. D’ailleurs, si cela n’en avait pas, on se demande bien pourquoi il aurait une station de métro à son nom à Montreuil ! Et sur ce sujet, permettez-moi de conclure non avec mes propres mots, mais avec ceux de Jean Jaurès. Car au début du XXe siècle comme au début du XXIe, la figure de Maximilien Robespierre, « l’Incorruptible » (c’était son surnom populaire !), a toujours fait débat. Je ne saurai trouver de meilleurs mots que ceux de Jaurès pour en parler. Les voici :
« Je ne veux pas faire à tous ces combattants qui m’interpellent une réponse évasive, hypocrite et poltronne. Je leur dis : ici, sous ce soleil de juin 93 qui échauffe votre âpre bataille, je suis avec Robespierre et c’est à côté de lui que je vais m’asseoir aux Jacobins.
OUI, je suis avec lui parce qu’il a à ce moment toute l’ampleur de la Révolution. Je suis avec lui parce que, s’il combat ceux qui veulent rapetisser Paris à une faction, il a gardé le sens révolutionnaire de Paris. (…)
Je ne crois point encore, avec et comme toi, impolitique et superflu d’évoquer les cendres et les principes de Robespierre et de Saint-Just pour étayer notre doctrine. D’abord, nous ne faisons que rendre hommage à une grande vérité, sans laquelle nous serions trop au-dessous d’une équitable modestie. Cette vérité est que nous ne sommes que les seconds Gracques de la Révolution française. N’est-il pas utile de montrer que nous n’innovons rien, que nous ne faisons que succéder à des premiers généreux défenseurs du peuple, qui avant nous avaient marqué le même but de justice et de bonheur auquel le peuple doit atteindre ?
Et, en second lieu, réveiller Robespierre, c’est réveiller tous les patriotes énergiques de la République, et avec eux le peuple qui, autrefois, n’écoutait et ne suivait qu’eux. Rendons à sa mémoire son tribut légitime; tous ses disciples se relèvent et bientôt ils triomphent. Le robespierrisme atterre de nouveau toutes les factions. Le robespierrisme ne ressemble à aucune d’elles ; il n’est ni factice ni limité. Le robespierrisme est dans toute la République, dans toute la classe judicieuse et clairvoyante et naturellement dans le peuple. La raison en est simple : c’est que le robespierrisme, c’est la démocratie, et ces deux mots sont parfaitement identiques. Donc, en relevant le robespierrisme, vous êtes sûrs de relever la démocratie. »