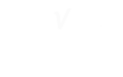Je veux partager avec vous une conversation marquante que j’ai eue ce vendredi à la gare RER de Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne, alors que je tractais pour la manifestation du 1er mai. Une dame s’arrête pour me saluer. Elle me remercie pour mon travail et « mes prises de parole ». Et elle me dit : « heureusement que vous êtes là, les insoumis, parce que sans vous ce serait dur… c’est inhumain ce qu’ils nous font ». Je lui demande ce qu’elle entend par là. Et voici ce qu’elle m’a dit :
« J’ai été adoptée. J’ai été élevée par mes grands-parents européens. Et aujourd’hui on me dit que je ne suis pas chez moi. On me dit “retourne chez toi”. Mais chez moi c’est ici. Je suis française. C’est ça qui est inhumain : ils ne comprennent pas la souffrance que ça provoque. »
– Témoignage d’une dame qui m’a interpellé lors d’un tractage
Je ne peux vous dire à quel point mon cœur s’est serré devant ce témoignage. Bien sûr, je sais à quel point le racisme est partout dans la société et à quel point son caractère systémique le rend inévitable dans notre pays. Bien sûr, je sais aussi à quel point ce racisme est brutal et violent, répété régulièrement, fait d’actes qui peuvent être à la fois perçus, à l’usure, comme « habituels » voire « normaux » (ils ne le sont pas) et d’autres qui marquent davantage, qui laissent des cicatrices morales ou physiques, et parfois même qui tuent.
Tout cela je le sais. Ou, pour être exact, je le comprends. Car quand on a ma couleur de peau, on ne peut pas savoir. On a ce privilège : jamais personne n’a remis en cause ce qu’on est sur la seule base de notre couleur de peau. On ne peut donc pas avoir un accès sensible à ces violences répétées. Et c’est une chance immense qui donne à ceux qui veulent être utiles d’abord le devoir de comprendre. C’est-à-dire, suivant l’étymologie latine, de « prendre avec soi » (cum-prehendere), d’accepter de porter avec soi en l’analysant une part de violence qu’on ne subit pas et, surtout, une part de la lutte nécessaire contre cette violence qu’on ne vivra pourtant jamais soi-même. Et pour comprendre, il faut commencer par écouter et surtout entendre ce que signifie, pour les personnes concernées, le fait de vivre le racisme au quotidien.
« La socialisation se déroule le plus souvent de manière implicite, c’est aussi ce qui fait sa force. Les expériences de racisme ou de discrimination en sont un bon exemple : elles vont avoir des effets sur nos manières de nous comporter, sur nos habitudes, etc., sans que l’on s’en aperçoive forcément. On va par exemple intérioriser une certaine auto-censure dans certains espaces, ou adopter des techniques d’évitement, ou bien développer des attitudes spécifiques qui sont en fait directement liées à ces expériences, ou même simplement à la connaissance de leur éventualité. Sortir systématiquement de chez soi avec sa carte d’identité, prévenir un·e employeur·se qu’on n’est pas blanc·he avant un entretien d’embauche, anticiper qu’il faudra se lisser les cheveux avant de s’y rendre, etc., sont autant de pratiques sociales qui sont racialement situées. Être témoin du racisme vécu par un parent lorsqu’on est enfant a aussi des effets : on apprend ainsi (sans le savoir) non seulement que le monde est hiérarchisé racialement, mais on intériorise aussi sa propre place (et celle des siens) dans ce monde. »
– Solène Brun, 2025, interview pour Manifesto XXI
Le RN menace les Français adoptés
Je disais donc : que le racisme soit une violence quotidienne avec des formes plus ou moins brutales, je le comprends. Mais le témoignage de la dame de la gare RER m’a touché particulièrement et sans doute pour trois raisons. La première, c’est qu’il faut n’avoir aucun cœur pour ne pas être touché par ses mots. La deuxième, c’est que cela rejoint un sujet que nous avons évoqué récemment à l’Assemblée nationale et où j’avais dénoncé l’abjection d’une proposition du RN. La troisième, c’est que ce que cette dame signale à travers ce témoignage, c’est ce qu’on appelle un « déni de francité ».
Je veux vous parler de ce « déni de francité », mais d’abord, je veux rappeler l’épisode auquel je fais référence à l’Assemblée. Car tout se tient ici. Il s’agissait d’un amendement du RN pour supprimer du code civil la possibilité pour un enfant étranger adopté par adoption simple ou placé dans une famille française de devenir lui-même français. J’avais à l’époque soulevé le sujet dès le passage de cet amendement devant la commission des lois, pensant que ce ne pouvait être qu’une erreur, et que le RN le retirerait en hémicycle. Mais il l’avait laissé, montrant que son racisme ne s’arrêtait donc même pas aux frontières de la famille. Je l’avais donc dénoncé avec force dans l’hémicycle.
🇫🇷 Le RN ne connaît rien à l’Histoire de France.
— Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) February 6, 2025
Supprimer le droit du sol, c’est attaquer ce qui fait de nous des Français.
S’en prendre aux enfants adoptés, c’est une honte absolue.
Le RN est l’ennemi de la France parce qu’il est l’ennemi de la République. pic.twitter.com/d6Sp9SGAc5
Cet épisode lamentable était passé inaperçu sur le plan médiatique, même si j’avais réussi à lui donner une certaine audience sur les réseaux sociaux (les différentes vidéos publiées sur le sujet totalisent plusieurs millions de vues). Il était pourtant la démonstration la plus absolue que le RN n’a pas changé et que ses obsessions racistes et xénophobes sont non seulement toujours profondément ancrées, mais plus encore au cœur de leur programme. Je pensais qu’un épisode où cela s’exprimait avec autant de clarté pourrait faire réagir jusqu’à leurs propres électeurs et, d’ailleurs, j’ai bel et bien vu sur mes vidéos des commentaires d’électeurs de Le Pen choqués de cette proposition. Mais globalement, et en dépit de mes tentatives, l’épisode était resté inaperçu.
Pourtant, tout se tient. Car derrière le témoignage de la dame de la gare RER de Sainte-Geneviève-des-Bois comme derrière cet amendement du RN, la question qui est finalement posée, c’est de savoir ce qui fait de nous des Français.
Pour le RN et les nazis, la Nation c’est le droit du sang
À l’extrême droite, la chose est entendue : comme Pétain avant eux, le RN veut supprimer le droit du sol, c’est-à-dire la possibilité de devenir Français pour tous ceux qui sont nés sur le sol de la République. Ils ont cette formule écoeurante : « la nationalité française, ça s’hérite ou ça se mérite ». Dit autrement : supprimer le droit du sol pour l’accès à la nationalité, c’est établir le droit du sang. Et dès lors toute une série de questions sont posées : un parent français suffit-il ou bien faut-il les deux ? Et pour définir la « francité » de ce parent, de quoi part-on ? De la loi préalablement existante ou de la nouvelle loi ? Et si on part de la nouvelle, dé-naturalise-t-on les Français qui ne rempliraient pas les conditions ? Et à combien de générations remonte-t-on pour définir qui est, in fine, Français ?
Ces questions, d’autres dans le passé y ont donné leur réponse. Ce sont les nazis. En 1935 avec les lois de Nuremberg, les nazis définissent ainsi ceux qu’ils considèrent comme « allemands » et comme « juifs », avec tout un tas de cas intermédiaires. Ces lois, qui concernent notamment la « protection du sang allemand » (sic) interdisent le mariage et, même, les relations sexuelles, entre personnes définies comme « allemandes » et définies comme « juives ». Elles mènent à la construction de schémas remontant jusqu’à la génération des grands-parents où les enfants sont représentés sous la forme de cercles composés de quatre quartiers (voir ci-dessous). Pour être de « sang allemand », il faut quatre grands-parents allemands, il faut quatre quartiers blancs dans son cercle. On est considéré comme « juif » dès lors qu’on a au moins trois grands-parents dits « juifs ». Et, dans tous les cas intermédiaires, c’est-à-dire dès lors que, dans sa généalogie on compte au moins une personne définie comme « juive », et même s’il s’agit d’un grand-parent sur quatre, on devient autre chose. On devient « mischling », ce qui pourrait se traduire par « hybride » ou « mélangé ».

Le régime de Vichy n’est pas en reste. Pétain arrive au pouvoir le 10 juillet 1940. Il fera de la question de la définition de la nationalité française une priorité. Le 22 juillet 1940, soit moins de deux semaines après son arrivée au pouvoir, Pétain promulgue une loi permettant de dé-naturaliser des Français ayant acquis la nationalité après 1927. Il vise ceux que les racistes de l’époque appelaient les « Français de papier timbré » parce que la demande de naturalisation devait être établie sur papier timbré, affranchi d’un timbre fiscal. Si cette expression vous parle encore aujourd’hui, c’est parce que le RN parle régulièrement de « Français de papier » pour désigner ceux qu’il estime faussement n’avoir pas d’autre attachement à la France que leur carte d’identité.
Pour le dire autrement : du point de vue raciste du RN, il y aurait des « vrais Français » (d’héritage ou de sang) et des « faux » (de papier). Et pour ces seconds, l’horizon permanent, c’est le « déni de francité », c’est-à-dire la mise en cause permanente de leur appartenance à la Nation. Sur ce point, notez que les nazis avaient poussé le vice et l’immonde des lois de Nuremberg en allant jusqu’à interdire aux personnes définies comme « juives » le droit de porter le drapeau du Reich (article 4 de la loi dite « sur la protection du sang et de l’honneur allemand »). Non seulement ils inventaient une définition de la Nation qui excluait toute personne définie comme « juive », mais encore fallait-il que les nazis empêchent cette personne de pouvoir d’une manière ou d’une autre revendiquer, même symboliquement, l’appartenance à la Nation par le port du drapeau.
Ce double refus d’appartenance à la Nation mis en place de manière crue et brutale par les nazis (« je ne veux pas de toi » ET « quoi que tu fasses tu ne seras jamais comme moi »), c’est précisément le mécanisme de fonctionnement sur lequel repose, in fine, le « déni de francité ». Je ne suis pas en train de dire que les racistes sont des nazis. J’ai d’ailleurs expliqué dans un autre texte comment le racisme s’insinue partout, même chez ceux qui prétendent parfois le combattre. Je dis, comme Aimé Césaire, qu’« au bout du capitalisme, désireux de se survivre, il y a Hitler. Au bout de l’humanisme formel et du renoncement philosophique, il y a Hitler », et que donc regarder dans les yeux ce que produit le racisme quand il devient un programme de gouvernement, c’est comprendre la part de danger qui pèse toujours sur nous dès lors qu’on n’a pas vaincu l’hydre raciste qui est non seulement un fait social mais qui, pour être un fait social, existe en chacun de nous. Et c’est pourquoi aussi, avec Frantz Fanon, je dis : « quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l’oreille : on parle de vous ». Car cela est à la fois un conseil pour le présent (toutes les luttes antiracistes se rejoignent et se renforcent dans leur unité là où l’ennemi raciste cherche précisément à les diviser et à les faire exister individuellement), mais aussi au regard du passé (regarder ce qu’ont fait ceux qui ont cherché à anéantir les juifs, c’est comprendre ce qui menace toute société qui n’a pas définitivement éradiqué le racisme).
Ce que veut dire le « déni de francité »
J’en reviens donc au « déni de francité », qui est l’objet de cette note de blog. La notion a été forgée par des chercheurs en sciences sociales qui cherchaient à expliquer le décalage entre le ressenti des individus (« je me sens français » ou « je me sens chez moi en France ») et la « francité » renvoyée par les habitants de notre pays qui, par des petits actes apparemment insignifiants (exemple : demander « tu es de quelle origine ? » en raison de la couleur de peau ou du nom), ou beaucoup plus matériels (exemple : refuser un logement ou un travail alors qu’on a les qualifications nécessaires et même davantage, etc.), ou carrément des actes violents (exemple : dire « retourne chez toi », « c’est pas ton pays ici », ou se livrer à des agressions physiques) vont renvoyer à une autre identité que l’identité française de la personne. Ce phénomène est par exemple celui que peut étudier un livre comme « La France tu l’aimes mais tu la quittes », qui traite du parcours de Français musulmans ayant quitté notre pays en raison du racisme qu’ils y subissaient et qui leur était devenu invivable. Une enquête conjointe de l’Insee et de l’Ined, « Trajectoires et origines », réalisée à deux reprises en 2008 et en 2019, a permis quant à elle d’objectiver ce phénomène par des données statistiques de grande ampleur.
Ce « déni de francité » est une souffrance pour nos compatriotes qui le vivent au quotidien. Et je dis bien « au quotidien », car dans notre société où le racisme est un système de domination aussi présent et puissant que le patriarcat, il n’existe pas un jour sans agression, sans « rappel à l’ordre », sans assignation à autre chose qu’à l’appartenance à la Nation. Je sais que beaucoup de personnes qui ne vivent pas le racisme penseront que j’exagère ; je sais que celles et ceux qui le vivent diront que je suis dans le vrai. Et c’est précisément aussi cette dichotomie ou cette méconnaissance qu’il faut maintenant régler pour de bon par une prise de conscience massive de la population française, comme le mouvement MeToo a permis sans doute de le faire, même imparfaitement, pour la question des violences sexistes et sexuelles en mettant en avant de leur caractère systémique. Raison pour laquelle, invité de Sud Radio cette semaine, j’ai dit qu’il était temps qu’un « MeToo des violences racistes » émerge dans notre pays.
Il y a 1 million d'actes racistes estimés en France.
— Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) April 17, 2025
Pourtant il n'y a que 12 000 plaintes.
Il y a eu un mouvement #MeToo des violences sexistes.
Il commence à y en avoir un sur les violences pédocriminelles.
Il est plus que temps qu’il y ait un MeToo des violences racistes pic.twitter.com/wNgwFQNVxg
J’en reviens au « déni de francité ». C’est celui dont me fait part la dame à la gare RER, c’est celui dont me fait part le jeune garçon qui me dit qu’à douze ans (douze ans !) il s’est déjà fait traiter de « kebab » par un policier, c’est celui d’un jeune homme (dont j’avais relayé la parole à l’Assemblée) qui m’avait dit, pour me parler là encore des violences policières qu’il avait subies, « on est tous Français, on doit avoir les mêmes droits », c’est celui de milliers et de millions de personnes dans notre pays qui vivent des milliers et des millions de violences symboliques ou physiques de ce type qui les ramènent, sans cesse, interminablement, à autre chose qu’à leur identité de Français.
Notre identité nationale est républicaine
Mais peut-être faut-il à ce stade dire ce qu’est cette identité, où du moins ce que nous pouvons entendre par là. J’ai dit ce qu’elle n’était pas. Elle n’est pas un héritage qui passerait par le sang. Et comme l’a souvent dit Jean-Luc Mélenchon, notre identité n’est pas une couleur de peau ; elle n’est pas une religion ; elle n’est pas une origine ; elle n’est pas même une langue puisque plusieurs pays l’ont en partage et que jusqu’à une période pas si éloignée que cela, ce critère n’était absolument pas pris en compte pour être Français – d’ailleurs, jusqu’au début du XXe siècle, tous les Français de l’Hexagone ne parlaient pas nécessairement toujours le français, mais c’est une autre histoire.
Non, notre identité nationale est républicaine. Ce qui fait de nous des Français, – du moins en théorie, car la pratique est loin du compte – c’est notre attachement à la République, et à sa devise : « Liberté, Égalité, Fraternité ». Cette identité est liée à notre citoyenneté. Et d’ailleurs, dans des temps pas si anciens, au moment de la Révolution française et de la Ière République, la notion de « nationalité » n’existait même pas. On n’acquérait pas la nationalité. On acquérait la citoyenneté. Et le mot « Nation » signifiait pour le résumer : « peuple souverain », c’est-à-dire l’ensemble des citoyens qui peuvent, par leur vote, prendre les décisions politiques qui concernent la vie commune.
D’ailleurs, comment définir l’égalité de manière matérielle autrement que par la citoyenneté et l’accès aux droits, dans un monde dans lequel les inégalités, en particulier sociales, sont partout ? L’égalité telle qu’on l’entend quand on est (vraiment) républicain est double. Elle tient d’abord dans la définition d’une humanité une et universelle pour laquelle on estime que chaque être humain qui la compose doit pouvoir bénéficier de droits « naturels et imprescriptibles », c’est-à-dire qui viennent avec la naissance et qui ne peuvent jamais être retirés. Elle tient ensuite dans la citoyenneté et le rapport au vote, puisqu’au moment de voter une personne égale une voix, riche ou pauvre, grand ou petit, femme ou homme, musulman, juif, chrétien ou athée, jeune ou vieux, homosexuel ou hétérosexuel. Et voilà donc comment nous sommes égaux : égaux en droits, égaux dans le vote, égaux dans le devoir de respecter la loi commune puisqu’elle est faite par tous (en théorie).
République et idéal républicain : ce que j’entends par là
Qu’il me soit permis à ce stade de dire une chose, et d’éclaircir un point sur l’usage que je fais des mots « République » ou « républicain » ou « idéal républicain ». Je souhaite le préciser en raison d’un tweet que j’ai fait récemment et appelant à diffuser largement en salles de cinéma le film « Fanon ». J’ai employé cette formule : « C’est si dur que ça de regarder en face notre passé colonial ? Comprendre que la colonisation est une trahison de l’idéal républicain, c’est pourtant être à la hauteur de cet idéal ». Un certain nombre de critiques – et, je préfère le dire d’emblée, totalement légitimes, – m’ont été formulées sur le sujet, en disant que cela revenait à nier que la colonisation et la République française, voire « l’idéal républicain » avaient été intrinsèquement liés (et j’ajouterais sont toujours, en pensant notamment à la Kanaky).
Je veux ici en dire quelques mots, car cela nous reliera, comme on le verra, directement à la question du « déni de francité ». Je commence par dire une chose : je ne nie rien de tout ce qu’on m’a accusé de nier, au contraire. Et j’avoue qu’en appelant à aller voir le film « Fanon » et en disant qu’il fallait « regarder en face notre passé colonial », je ne pensais pas que cela pourrait être une critique qu’on me ferait. Je répète néanmoins que je la trouve légitime. Car en faisant ce tweet, je partais du présupposé erroné que ceux qui allaient le lire avaient lu ou vu aussi ce que j’avais pu écrire ou dire au sujet de la République et de son « idéal », de l’esclavage, de la colonisation, du racisme, et qu’à mes yeux cela forme un tout cohérent dans lequel on comprend bien que quand je parle d’« idéal républicain », je parle bien davantage de quelque chose qui reste à écrire que de quelque chose qui aurait déjà été écrit.
Je résume l’idée. À mes yeux, la République française, ses principes, son idéal et les symboles qui vont avec sont l’objet d’une bataille. Une bataille qui n’appartient pas au passé. Une bataille actuelle et, pour tout dire, une bataille permanente qui ne s’achèvera sans doute pas de notre vivant. Cette bataille, pour moi, et contrairement à ce que j’ai pu voir à plusieurs reprises sur ce qu’on dit de moi, ne consiste pas à « écrire un roman national ». Elle consiste au contraire à contester les romans nationaux. Elle consiste à déconstruire les mécanismes qui conduisent à avoir l’impression que l’Histoire est faite d’actes de statues figées dans le temps qui ont agi comme elles ont agi parce que « ça allait de soi » ou parce que « c’était comme ça qu’on pensait à l’époque ». Et il est précisément très difficile de penser hors de ces cadres à la fois parce qu’ils ont la force de l’évidence (« ça s’est passé comme ça donc ça n’aurait pas pu se passer autrement ») et parce que l’Histoire que l’on retient est d’abord toujours le récit des vainqueurs.
Rendre visible l’Histoire des dominés : le fil rouge de l’Histoire
Ce que j’essaie de faire, donc, quand je puise dans l’Histoire, ce n’est pas d’inventer un contre-récit ou un nouveau roman national. C’est de mettre en lumière des éléments largement ignorés, passés sous silence, invisibilisés. C’est à dire souvent de parler de l’Histoire des dominés, des vaincus, des perdants, de ceux qui à mes yeux « étaient dans le vrai » mais se sont fait tuer, emprisonner, exiler, esclavagiser ou même ont tout simplement sont devenus invisibles avec le temps, par l’absence de traces laissées ou par la sur-visibilisation d’autres de leurs contemporains. Ce que j’essaie de faire, c’est de critiquer une vision de la République portée par les dominants qui ont fait la République telle qu’elle est et telle qu’elle a été pour vérifier si, au regard des principes et des contemporains de cette époque-là, d’autres disaient autre chose et auraient permis qu’on fasse autrement si on les avait écouté eux plutôt que d’autres. Cela ne veut pas dire ignorer ou dédouaner la République et ceux qui se prétendaient « républicains » de leurs actes et de leur responsabilité. Au contraire ! C’est précisément les juger avec la dureté qu’ils méritent, puisque d’autres qu’eux disaient autre chose qu’eux et qu’ils auraient pu choisir de les écouter.
Et précisément en creusant dans l’Histoire, ce qu’on constate, c’est qu’il n’y a aucune époque, jamais, nulle part, où les choses seraient allées « de soi ». Les personnes placées en esclavage se sont toujours rebellées contre l’esclavage. Les personnes colonisées se sont toujours rebellées contre la colonisation. Et du côté des dominants aussi il y avait des gens, minoritaires certes, mais bien présents, pour critiquer ce qui était fait. Aussi ai-je déjà eu l’occasion de dire, à propos de la colonisation, que quand Jules Ferry fait son discours pour la justifier en affirmant, le 28 juillet 1885, « il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures », je suis, moi, dans l’Assemblée nationale, aux côtés de Julien Maigne, qui siège à l’extrême gauche et qui affirme : « Oh ! Vous osez dire cela dans le pays où ont été proclamés les droits de l’Homme ! ». Et en disant cela, je ne nie pas que la République a été la puissance coloniale qu’en a fait Jules Ferry. En disant cela, je dis que la République à cet instant, que l’idéal républicain que je défends à cet instant, c’est Julien Maigne qui le porte et qui porte ma voix dans ce moment de l’Histoire. De la même manière qu’entre les Versaillais et les Communards, je choisis mon côté de la barricade et je me mets avec Louise Michel du côté des déportés et fusillés de la Commune plutôt que de leurs assassins Versaillais. De la même manière qu’entre Robespierre et ses meurtriers, je choisis Robespierre, même si sur d’autres questions je choisis de me placer face à lui plutôt qu’à ses côtés.
En bref, ce que je cherche dans l’Histoire c’est un fil (rouge, si j’ose dire). Un fil qui nous relie toujours à une idée : celle de l’égalité entre les êtres humains. Je cherche ce fil partout où je peux le trouver et, pour ce qui concerne l’Histoire de France, je le cherche évidemment au moment de la Révolution de 1789 et surtout 1792, parce que c’est le moment où les principes le proclament de manière très officielle (ce qui ne veut pas dire non plus que cela ait été pour autant respecté). Mais je ne le cherche pas qu’ici, je le cherche partout : je suis aux côtés de Jean-Baptiste Belley pour l’abolition de l’esclavage en 1794 ; du côté des Haïtiens à la bataille de Vertières en 1803 ; du côté des républicains pendant les Trois Glorieuses en 1830 ; du côté des socialistes révolutionnaires en 1848 ; avec les Communards en 1871 ; avec les soldats mutins du 17e régiment en 1907 ; avec les manifestants antifascistes en 1934 et je vote pour le Front populaire en 1936 ; je suis avec les Résistants entre 1940 et 1945, je célèbre la victoire sur les nazis le 8 mai 1945 et je suis ce jour-là du côté des habitants de Sétif, Guelma et Kherrata ; je suis dans la rue en mai 1968 ; je crois qu’on a gagné en 1981 et je suis déçu en 1983 ; je dis non au traité constitutionnel européen en 2005 ; j’ai un gilet jaune sur le dos en 2018 et 2019 ; je n’appelle pas au calme mais à la justice pendant les révoltes de juin 2023. Quand je parle de l’« idéal républicain », c’est ce fil que j’évoque. Quand je parle de la République, c’est ce fil que j’évoque. Et encore ! Je ne parle ici que de l’Histoire de France, car ce fil peut être cherché partout : avec Guevara comme avec Sankara. Et je précise que je le cherche aussi dans le présent et que j’essaie toujours de placer ma propre action au regard de ce fil.
La République est toujours l’objet d’une lutte
Ce fil rouge d’un idéal sans cesse travaillé, sans cesse renouvelé, sans cesse amélioré période historique après période historique, c’est celui qu’évoque Léon Blum au moment du procès que lui fait le régime de Vichy. Nous sommes en 1942, à Riom, et Léon Blum est alors du côté des vaincus, des perdants, de ceux qui n’ont a priori devant eux plus que la prison, le camp, la mort. Et voici ce qu’il dit :
« Messieurs, j’ai achevé. Vous pourrez naturellement nous condamner. Je crois que, même par votre arrêt, vous ne pourrez pas effacer notre œuvre. Je crois que vous ne pourrez pas effacer notre œuvre. Je crois que vous ne pourrez pas — le mot vous paraîtra peut être orgueilleux — nous chasser de l’Histoire de ce pays. Nous n’y mettons pas de présomption, mais nous y apportons une certaine fierté : nous avons dans un temps bien périlleux, personnifié et vivifié la tradition authentique de notre pays, qui est la tradition démocratique et républicaine. De cette tradition, à travers l’histoire, nous aurons malgré tout été un moment. Nous ne sommes pas je ne sais quelle excroissance monstrueuse dans l’histoire de ce pays, parce que nous avons été un gouvernement populaire ; nous sommes dans la tradition de ce pays depuis la Révolution Française. Nous n’avons pas interrompu la chaîne, nous ne l’avons pas brisée, nous l’avons renouée et nous l’avons resserrée. Naturellement, il est facile quand on dispose de tous les moyens qui agissent sur l’opinion de défigurer notre œuvre, comme on peut défigurer notre personne ; notre visage. Mais la réalité est là et elle se fera jour (…). Quand on nous dit : “Vous avez eu tort, il fallait agir autrement” on nous dit nécessairement, forcément, “il fallait briser et trahir la volonté exprimée par le peuple”. Nous ne l’avons ni trahie, ni brisée par la force, nous y avons été fidèles. Et Messieurs, par une ironie bien cruelle, c’est cette fidélité qui est devenue une trahison. Pourtant cette fidélité n’est pas épuisée, elle dure encore et la France en recueillera le bienfait dans l’avenir où nous plaçons notre espérance et que ce procès, ce procès dirigé contre la République, contribuera à préparer. »
– Léon Blum, 1942, procès de Riom
Ces mots sont ceux d’un homme qui, à l’heure où la nuit est partout, décide de maintenir allumé un flambeau en prenant à témoin le passé, le présent et le futur. Il a perdu pour l’instant, mais il nous prend, nous, à témoins, pour lui donner la victoire. Et chaque période de l’Histoire est ainsi, y compris celle dont nous sommes, nous, aujourd’hui, en train d’écrire la page. Je vais prendre des exemples contemporains pour qu’on me comprenne bien. Le parti « Les Républicains » est-il républicain au sens où je l’entends compte tenu de ce que je viens de dire ? Non. Parce que ses chefs véhiculent des propos sexistes, racistes, xénophobes, transphobes, homophobes. Ce n’est pas l’idée que je me fais de la République. Mais pas plus que Staline n’est l’idée que je me fais du communisme ou François Hollande l’idée que je me fais du socialisme. Il y a les mots, il y a les idées, il y a ceux qui se revendiquent des mots sans porter les idées ou, pire, en les salissant. Et pourtant Staline participe à l’Histoire du communisme, Hollande à l’Histoire du socialisme, « Les Républicains » à l’Histoire de la République. Mais j’estime que j’ai le droit de contester à tous ces gens l’usage ou plutôt le sens de ces mots.
Pourquoi est-ce important ? Parce que cela nous ramène au présent et, justement, au « déni de francité » qui est ressenti par beaucoup de nos compatriotes. Ce « déni de francité » qui s’exprime repose sur une définition raciste de la Nation. Pour être capable de le contester avec force, il faut donc être en capacité de proposer une autre définition de la Nation. Et, pour aller jusqu’au bout de cette idée, une définition qui rende impossible l’usage de cette notion pour produire des formes renouvelées de discriminations ou de hiérarchisations qui s’appuieraient sur elle. Car si nous définissons une Nation française et que, ce faisant, nous reproduisons des mécanismes nationalistes, alors nous passons à côté de l’enjeu qui est pourtant posé. Raison pour laquelle, tout en réfléchissant à ce que nous sommes comme Français, j’essaie pour ma part de ne jamais perdre de vue que cette catégorie n’est pas une fin en soi et que, dans un monde où nous aurions laissé de côté les Nations, cette catégorie aurait été une étape vers l’unité humaine. J’entends cet objectif et cette pratique de l’action politique au sens où sans doute l’entendaient Marx et Engels dans Le Manifeste du Parti communiste : « Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut leur prendre ce qu’ils n’ont pas. Comme le prolétariat doit en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s’ériger en classe nationale, se constituer lui-même en nation, il est encore par là national, quoique nullement au sens où l’entend la bourgeoisie ». C’est à cela que je pense.
Car même si je défends l’héritage intellectuel et politique des minorités et des minoritaires de la République, même si je défends l’Histoire de France des vaincus contre celle des vainqueurs (encore que, par moments sublimes et immortels, nous ayons nous aussi connu nos victoires !), je n’aspire ni à perdre le combat ni à être minoritaire. Au contraire : j’aspire à la victoire. Je dis que c’est bientôt l’heure des damnés de la Terre et des forçats de la faim et que si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. Mais pour y parvenir, je pense qu’il faut y aller étape par étape, n’en omettre aucune, et que cela exige d’être capable de répondre point par point aux failles que nos adversaires essaient de déployer en nous ou à l’intérieur de notre peuple.
Face au « déni de francité », la stratégie du drapeau
Aussi ai-je une réflexion somme-toute assez simple : si nos adversaires fascistes ont fait du « déni de francité » une stratégie politique, si ce « déni de francité » est produit et reproduit de manière régulière par le caractère systémique du racisme dans notre société, l’une des manières les plus performantes d’y répondre et de contre-attaquer est de saper les bases sur lesquelles ce racisme et le déni qui va avec s’appuient. Bien sûr, cela signifie donc lutter contre toutes les formes de racisme, en expliquer les ressorts, faire comprendre à tout le monde que personne n’est exempt de la possibilité de produire et reproduire des comportements racistes, – y compris les militants antiracistes et de gauche, – de la même manière que personne n’est exempt de produire et reproduire des comportements machistes. Mais à mes yeux, cela signifie aussi répondre mot pour mot, ou plutôt barricade par barricade à nos adversaires. Et puisque l’un des vecteurs de la lutte de nos adversaires est vis-à-vis de nos compatriotes celui du « déni de francité », je dis qu’il est indispensable de contester le sens de cette « francité » à nos adversaires pour rendre impossible ce déni à nos compatriotes.
Car si nous définissons une identité française qui n’est pas celle de nos adversaires, si cette identité n’est ni excluante ni nationaliste, si cette identité porte en elle le programme politique de la devise « Liberté, Égalité, Fraternité », si elle fait des droits civiques, sociaux, écologiques et démocratiques le centre de sa définition, si elle est incompatible avec le racisme, la xénophobie, le sexisme, l’homophobie, la transphobie, ou d’une manière générale les discriminations, bref, si nous faisons tout cela à la fois et qu’au nom de cette identité républicaine renouvelée, nous acceptons aussi de regarder en face ce qui est fait et a été fait au nom d’une identité républicaine officielle mais contestable, comme la colonisation, alors si nous faisons tout cela, nous rendons difficile voire impossible le « déni de francité ». Et en réalité, nous ramenons ceux qui produisent ce déni devant l’obligation de faire un choix : racisme ou République ? Nous l’exprimons ainsi crûment et sans équivoque : nous faisons émerger la dualité qui devrait être évidente au regard des principes qui sont pourtant proclamés dans nos textes. Et je dis, avec Aimé Césaire :
« Une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente.
– Aimé Césaire, 1950, Discours sur le colonialisme
Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte.
Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. »
L’objet ici, c’est de ne plus « ruser avec les principes ». C’est de les établir de manière renouvelée à la fois au regard de ceux qui ont été définis dans le passé (à la Révolution et après), en les renforçant de ceux que nous portons aujourd’hui. Car les principes se renforcent en s’additionnant quand ils entrent en résonance et sont mis en cohérence. Je sais, en écrivant ces mots, que le moment victorieux de la lutte dont je pose ici quelques principes d’action peut paraître bien lointain. Mais en est-il autrement des autres luttes que nous menons ? Je ne le crois pas. Et, comme je le disais plus haut, je n’aspire pas à être éternellement minoritaire. J’aspire à ce que notre camp politique gouverne le pays. Mener cette bataille est donc aussi indispensable à mon sens pour exercer le pouvoir. Sauf à dire que nous commencerions la 6e République par un changement de drapeau, d’hymne, de devise, et d’une manière générale de tout ce qui fait notre identité nationale actuelle sur le plan purement symbolique. Ne fétichisant rien, je ne dis pas nécessairement que cela soit une mauvaise idée en soi. Je pense juste que ce n’est pas une aspiration majoritaire de notre peuple aujourd’hui (je pense même que c’est une aspiration ultra-minoritaire, quoique je me sente politiquement souvent très proche des gens qui portent cette opinion) et que cela reviendrait d’emblée à se créer des problèmes stratégiques supplémentaires que ceux – nombreux – que nous avons déjà à résoudre pour obtenir la victoire puis gouverner le pays. Je pense donc plus utile stratégiquement et plus efficace politiquement – et peut-être aussi parce que nous manquons de temps – d’alimenter positivement un contre-modèle de « francité » qui s’oppose en tout point à celui de l’extrême droite, et dont j’ai défini les contours un peu plus haut.
Mener la bataille de l’identité française pour rendre majoritaire celle d’un idéal républicain renouvelé (féministe, antiraciste, décolonial), c’est ce que j’ai appelé la « stratégie du drapeau ». J’en ai parlé longuement dans une conférence à Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye que je vous invite à regarder si vous avez eu la patience de me lire jusqu’ici. Je ne dis pas que cette stratégie soit parfaite, ni même que je ne commette pas d’erreur en la mettant en œuvre (ça arrive). J’essaie d’ailleurs de l’améliorer par touches, petit à petit, avec des camarades qui m’y aident, pour qu’elle permette de rassembler aussi largement que possible et que personne ne s’en sente exclu (même si je sais que, comme pour toute stratégie politique, on ne peut jamais faire l’unanimité). Je constate empiriquement que celles et ceux qui me remercient le plus souvent de la mettre en œuvre sont des personnes qui subissent le racisme et qui comprennent peut-être plus que d’autres dans leur chair la nécessité de disposer d’un outil et d’un corpus théorique qui permettent de retourner le stigmate devant ceux qui le leur font subir.
Le corpus se construit pas à pas, et en particulier à chaque fois que je reçois des critiques qui permettent d’en questionner la validité et la pertinence. L’outil, lui, est facilement accessible puisqu’il s’agit d’un drapeau. Je vois d’ailleurs que, de plus en plus dans nos manifestations, le drapeau tricolore est désormais mobilisé dans ce contexte bien précis avec une vocation antiraciste. Et je ne crois pas que ce soit de mon fait, loin de là. Il s’agit de réflexes spontanés. Je l’avais d’ailleurs constaté avec énormément de force bien avant de me saisir de ce sujet lors de la manifestation contre l’islamophobie du 10 novembre 2019 où des centaines de drapeaux tricolores émaillaient la manifestation. Et, à bien y réfléchir, cela n’a rien d’étonnant. Car c’est tout simplement la logique pour quiconque subit un « déni de francité » que d’affirmer par le moyen simple de porter le drapeau tricolore que les racistes n’emporteront pas la victoire. Et je crois, en effet, qu’ils ne l’emporteront pas. Comme je l’ai montré en citant Léon Blum, nous le leur avons dit à plusieurs reprises dans notre Histoire. Nous l’avons fait de nouveau avec force le 7 juillet 2024 au deuxième tour des élections législatives. Et nous saurons le leur dire de nouveau à chaque fois qu’il le faudra. Pour une raison simple : ce pays est à nous. Et « déni de francité » ou non, ce n’est pas près de changer. Ou, pour le dire avec les mots qui résumeront en une phrase tout ce que j’ai dit auparavant :
La République, c’est nous !